RETROUVER OULED MOUMEN

Bâti sur une vaste oliveraie au sud de Marrakech, Oulad Moumen est le village où fut fondée dans les années 10 la famille Edery. La migration, marocaine d'abord, mondiale ensuite, a transplanté les membres de cette famille, les a séparés, transformés et assimilés à d'autres cultures. Izza Génini, réalisatrice, les réunit à Oulad Moumen, sur les lieux de leurs origines. Le film retrace la saga de cette migration exemplaire à laquelle s'identifie la multitude des familles éclatées.
| Réalisateur | Izza Genini / عزة جنيني |
| Acteur | Haja El Hamdaouia / الحاجة الحمداوية |
| Partager sur |
RETROUVER OULED MOUMEN
en VOD
de Izza Génini
Documentaire, Maroc, 1991
Bâti sur une vaste oliveraie au sud de Marrakech, Oulad Moumen est le village où fut fondée dans les années 10 la famille Edery. La migration, marocaine d'abord, mondiale ensuite, a transplanté les membres de cette famille, les a séparés, transformés et assimilés à d'autres cultures. Izza Génini, réalisatrice, les réunit à Oulad Moumen, sur les lieux de leurs origines. Le film retrace la saga de cette migration exemplaire à laquelle s'identifie la multitude des familles éclatées.
OHRA Productions
 Prix du Festival du film d'histoire de Pessac, France, 1995
Prix du Festival du film d'histoire de Pessac, France, 1995
"Un jour de mars 1992, je tins le pari de réunir ma famille dispersée à Oulad Moumen, dans le sud de Marrakech, là où mes parents la fondent dans les années 10. Ce retour à notre passé fit comme s'évanouir les années écoulées depuis. Elles étaient pourtant bien là, ces années : dans le témoignage de nos amis et voisins arabes, dans les documents d'archives historiques et familiales, dans ceux rares et précieux de la vie judéo-arabo-berbère du Maroc. Elles étaient aussi dans la vie quotidienne de ma famille, partie d'une ferme d'oliviers dans le sud marocain et qui, en neuf enfants et deux ou trois générations, a décrit les grandes étapes de la migration humaine, du régionalisme le plus serré au mondialisme le plus éclaté, de la connaissance d'un langue unique et dialecte (l'arabe) au multilinguisme coloré. Ces changements n'ont pas pour autant signifié la rupture avec nos racines."
Izza Génini
Extrait d'un entretien avec Le Matin - Propos recueillis par Ouafaâ Bennani, 2021
Retrouver Ouled Moumen, projeté au dixième Festival international de cinéma et de mémoire commune, est une sorte d’autobiographie. Comment s’est déroulé le processus de sa réalisation ?
Ce processus a commencé avec mon retour au Maroc. La deuxième pierre est que ce retour au Maroc m’a donné l’impulsion de me lancer dans la distribution des films marocains, en rencontrant Souhaïl Benbarka. Après avoir produit «Al Hal», je voulais continuer à produire pour le cinéma un film avec Fatna Bent El Houssine que j’admirais beaucoup. Comme c’était très compliqué de produire «Transe», je n’étais pas prête à recommencer. C’est à ce moment-là que j’ai pensé à la réalisation. Après onze films de 26 min, je me suis rappelée des rushes de l’interview de mes parents, puis la célébration de mon anniversaire et je me suis trouvée à un festival à Biarritz, avec Canal+ qui diffusait en été une émission sur la diaspora familiale, et c’est un film sur ma famille qui m’est venu à la tête. Alors, j’ai proposé l’idée, qui fut acceptée sous conditions.
Ce documentaire a-t-il marqué les membres de votre famille ?
Ce film a reçu le grand prix du film d’histoire à Pessac et même notre frère, qui n’avait pas aimé l’idée au départ, en était content, surtout après que le film a été sélectionné à New York où il habitait dans le temps. Quand il a vu le film, il a craqué et est devenu le plus grand défenseur du documentaire. Comme si lui-même avait besoin que cette vérité éclate devant le monde entier. D’ailleurs, mon attention était de faire ce travail, parce que moi aussi, à mon adolescence, j’avais le complexe de mes parents en djellaba, alors ceux de mes copines étaient en costumes. Tout d’un coup, par ce retour au Maroc, où j’ai appris à les connaître, je me suis dit que ce sont des gens d’une immense valeur. Donc, le travail du film était de valoriser ces personnes, les sortir du complexe, de l’indignité. Alors qu’ils ont un savoir qui a tellement de valeur. Je suis plus que fière de ce film, surtout en rendant hommage à ma mère et toutes les femmes qui ont vécu ces temps qui furent assez difficiles pour elles.
Avez-vous continué sur la même voie après ce film ?
Oui, j’ai continué à creuser dans la culture marocaine en réalisant «Pour le plaisir des yeux» sur les neggafates, car je me suis rendu compte que le Maroc est une vraie civilisation. Il y a un art de vivre, une esthétique, partagée entre la population musulmane et juive.
Comment considérez-vous la relation actuelle entre juifs et musulmans ?
Il y a toujours cette relation amicale et d’amour entre les deux. D’abord, on peut circuler librement au Maroc, pas comme dans certains pays. Il faut dire que ceci est aussi valable pour tous les étrangers, car le Maroc est un pays très accueillant.
Qu’est-ce que vous nous préparez pour le prochain documentaire ?
En regardant mes archives, j’ai retrouvé Hajja Hamdaouiya, Chekara, les frères Bouazzaoui, des vrais trésors, puis mon rapport avec Souk Al Gara et mon amour pour le Maroc, pour sa culture et ses musiques m’ont poussée à préparer un film intitulé «Mon souk Lakhmiss».
Où en le projet des proverbes «Comme ma mère disait» ?
Comme il va y avoir à Paris, au mois de janvier, toute une quinzaine de la culture juive d’Afrique du Nord au centre communautaire, ils nous ont demandé d’en faire un spectacle : ma fille va faire la mise en scène, moi je vais lire le texte et Françoise va le chanter.
-

RETROUVER OULED MOUMEN
50 mn
Langue : Français
- Année 1991
- Durée 0h50
- Origine Maroc
- Sous-titres disponibles Français
- Langues disponibles Version originale (Arabe et français)
RETROUVER OULED MOUMEN
en VOD
de Izza Génini
Documentaire, Maroc, 1991
Bâti sur une vaste oliveraie au sud de Marrakech, Oulad Moumen est le village où fut fondée dans les années 10 la famille Edery. La migration, marocaine d'abord, mondiale ensuite, a transplanté les membres de cette famille, les a séparés, transformés et assimilés à d'autres cultures. Izza Génini, réalisatrice, les réunit à Oulad Moumen, sur les lieux de leurs origines. Le film retrace la saga de cette migration exemplaire à laquelle s'identifie la multitude des familles éclatées.
OHRA Productions
 Prix du Festival du film d'histoire de Pessac, France, 1995
Prix du Festival du film d'histoire de Pessac, France, 1995
"Un jour de mars 1992, je tins le pari de réunir ma famille dispersée à Oulad Moumen, dans le sud de Marrakech, là où mes parents la fondent dans les années 10. Ce retour à notre passé fit comme s'évanouir les années écoulées depuis. Elles étaient pourtant bien là, ces années : dans le témoignage de nos amis et voisins arabes, dans les documents d'archives historiques et familiales, dans ceux rares et précieux de la vie judéo-arabo-berbère du Maroc. Elles étaient aussi dans la vie quotidienne de ma famille, partie d'une ferme d'oliviers dans le sud marocain et qui, en neuf enfants et deux ou trois générations, a décrit les grandes étapes de la migration humaine, du régionalisme le plus serré au mondialisme le plus éclaté, de la connaissance d'un langue unique et dialecte (l'arabe) au multilinguisme coloré. Ces changements n'ont pas pour autant signifié la rupture avec nos racines."
Izza Génini
Extrait d'un entretien avec Le Matin - Propos recueillis par Ouafaâ Bennani, 2021
Retrouver Ouled Moumen, projeté au dixième Festival international de cinéma et de mémoire commune, est une sorte d’autobiographie. Comment s’est déroulé le processus de sa réalisation ?
Ce processus a commencé avec mon retour au Maroc. La deuxième pierre est que ce retour au Maroc m’a donné l’impulsion de me lancer dans la distribution des films marocains, en rencontrant Souhaïl Benbarka. Après avoir produit «Al Hal», je voulais continuer à produire pour le cinéma un film avec Fatna Bent El Houssine que j’admirais beaucoup. Comme c’était très compliqué de produire «Transe», je n’étais pas prête à recommencer. C’est à ce moment-là que j’ai pensé à la réalisation. Après onze films de 26 min, je me suis rappelée des rushes de l’interview de mes parents, puis la célébration de mon anniversaire et je me suis trouvée à un festival à Biarritz, avec Canal+ qui diffusait en été une émission sur la diaspora familiale, et c’est un film sur ma famille qui m’est venu à la tête. Alors, j’ai proposé l’idée, qui fut acceptée sous conditions.
Ce documentaire a-t-il marqué les membres de votre famille ?
Ce film a reçu le grand prix du film d’histoire à Pessac et même notre frère, qui n’avait pas aimé l’idée au départ, en était content, surtout après que le film a été sélectionné à New York où il habitait dans le temps. Quand il a vu le film, il a craqué et est devenu le plus grand défenseur du documentaire. Comme si lui-même avait besoin que cette vérité éclate devant le monde entier. D’ailleurs, mon attention était de faire ce travail, parce que moi aussi, à mon adolescence, j’avais le complexe de mes parents en djellaba, alors ceux de mes copines étaient en costumes. Tout d’un coup, par ce retour au Maroc, où j’ai appris à les connaître, je me suis dit que ce sont des gens d’une immense valeur. Donc, le travail du film était de valoriser ces personnes, les sortir du complexe, de l’indignité. Alors qu’ils ont un savoir qui a tellement de valeur. Je suis plus que fière de ce film, surtout en rendant hommage à ma mère et toutes les femmes qui ont vécu ces temps qui furent assez difficiles pour elles.
Avez-vous continué sur la même voie après ce film ?
Oui, j’ai continué à creuser dans la culture marocaine en réalisant «Pour le plaisir des yeux» sur les neggafates, car je me suis rendu compte que le Maroc est une vraie civilisation. Il y a un art de vivre, une esthétique, partagée entre la population musulmane et juive.
Comment considérez-vous la relation actuelle entre juifs et musulmans ?
Il y a toujours cette relation amicale et d’amour entre les deux. D’abord, on peut circuler librement au Maroc, pas comme dans certains pays. Il faut dire que ceci est aussi valable pour tous les étrangers, car le Maroc est un pays très accueillant.
Qu’est-ce que vous nous préparez pour le prochain documentaire ?
En regardant mes archives, j’ai retrouvé Hajja Hamdaouiya, Chekara, les frères Bouazzaoui, des vrais trésors, puis mon rapport avec Souk Al Gara et mon amour pour le Maroc, pour sa culture et ses musiques m’ont poussée à préparer un film intitulé «Mon souk Lakhmiss».
Où en le projet des proverbes «Comme ma mère disait» ?
Comme il va y avoir à Paris, au mois de janvier, toute une quinzaine de la culture juive d’Afrique du Nord au centre communautaire, ils nous ont demandé d’en faire un spectacle : ma fille va faire la mise en scène, moi je vais lire le texte et Françoise va le chanter.
-

RETROUVER OULED MOUMEN
Durée : 50 minutesLangue : Français50 mn
- Année 1991
- Durée 0h50
- Origine Maroc
- Sous-titres disponibles Français
- Langues disponibles Version originale (Arabe et français)
Vous aimerez aussi

POUR LE PLAISIR DES YEUX
Prix : DH 20.00
"L'art de l'embellissement repose entre les mains d'une femme nommée Zyana dans le Nord, Neggaffa partout ailleurs au Maroc. Hajja Khadija nous initie aux secrets et de la beauté et de la séduction...." La documentariste Izza Génini et sa caméra à la fois ethnographe et intimiste, si proche des corps, des visages et des objets, nous immergent dans les merveilles d'un patrimoine culturel marocai...

TAMBOURS BATTANT
Prix : DH 20.00
Les tambours emplissaient l'espace. Il y en avait des ronds, des plats, des ventrus... Il y en avait de minuscules et d'énormes comme ceux des musiciens qui venaient virevolter sous nos fenêtres à Casablanca..." Izza Génini se souvient et s'interroge à travers ce film sur la place mystérieuse que tient la musique dans sa relation à un être, à son monde d'origine mais aussi et surtout à lui-même...

NÛBA D'OR ET DE LUMIÈRE
Prix : DH 20.00
Nûba d'or et de lumière raconte l'histoire d'une musique. La musique arabo-andalouse dont la nûba serait la symphonie... A l'image d'un arbre musical, ses branches sont nourries d'une sève qui, depuis 14 siècles, monte des confins marocains et des courants venus d'Arabie, grandit dans les cours des califes andalous, se fortifie dans l'Espagne médiévale, se mêle au chant des trouvères et des sép...

AÏTA
Accès abonnement
Interprété par les cheikhate - musiciennes itinérantes - la aîta est le cri qui devient chant, chant qui devient appel : appel à la memoire, appel à temoin de la douleur, appel au depassement de sol, la aïta est aussi un cri d'amour et d'espérance. Au Moussem de Moulay Abdallah, au sud de Casablanca, la diva marocaine Fatna Bent El Hocine et sa troupe Oulad Aguida réjouissent les milliers de ca...
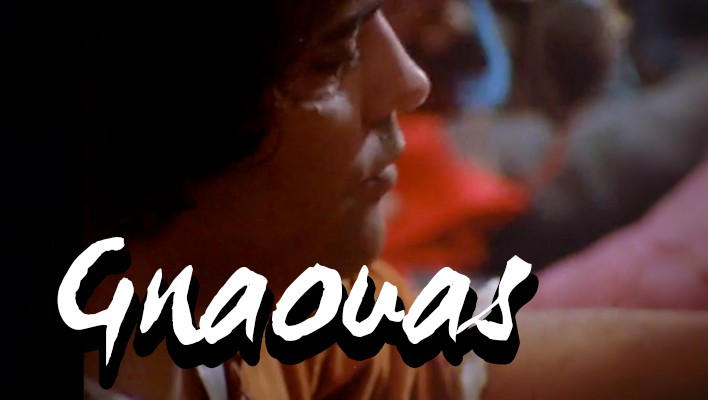
GNAOUAS
Accès abonnement
L’Afrique Noire coule dans les veines du Maroc. Esclaves arrivés dès le XV° siècle avec l'or du Soudan Occidental, les Gnaouas ont formé des confréries qui pratiquent encore des rituels de possession et d'exorcisme. Au cours de la lila, les chants en bambara, le rythme du guembri, le crépitement des crotales métalliques et le battement sourd du tambour appellent les mlouks, les génies bienveill...

MOUSSEM
Accès abonnement
Fête populaire, pèlerinage religieux, souk et foire commerciale, le Moussem est la manifestation la plus emblématique de la vie traditionnelle marocaine. A Moulay Abdallah, face à l'Océan Atlantique, au sud d'El Jadida, plus d'un millier de chevaux et de cavaliers se réunissent pour la compétition de plus célèbre des fantasias. Toufik NAOMI, 22 ans, l'un des plus doués des cavaliers, en sera l'...

MALHOUNE
Accès abonnement
Le malhoune signifie "parole dialectale chantée. A Meknès, Hajj Houceine Toulali, maître incontesté de ce genre musical nous révèle les subtilités de cette langue millénaire et savoureuse. Réunis dans les traditionnels salons de musique, les amateurs éclairés et de simples artisans composent des poèmes sur un rythme cadencé.

LOUANGES
Accès abonnement
Entre Volubilis et Meknès, le sanctuaire de Moulay Idriss 1er est le théâtre d'un des plus importants pèlerinages du Maroc. Pendant huit jours, au son des tambours et des hautbois, confréries soufi et simples pèlerins défilent sur des rythmes lancinants, en quête de bénédictions et de transes libératrices.

DES LUTHS ET DÉLICES
Accès abonnement
C’est à Tétouan surnommée "Fille de Grenade" que le légendaire maître de musique Abdelsadek Chekara et son orchestre interprètent le répertoire classique arabo-andalou des noubas, suites musicales aux accents de flamenco, héritées l'Andalousie toute proche.
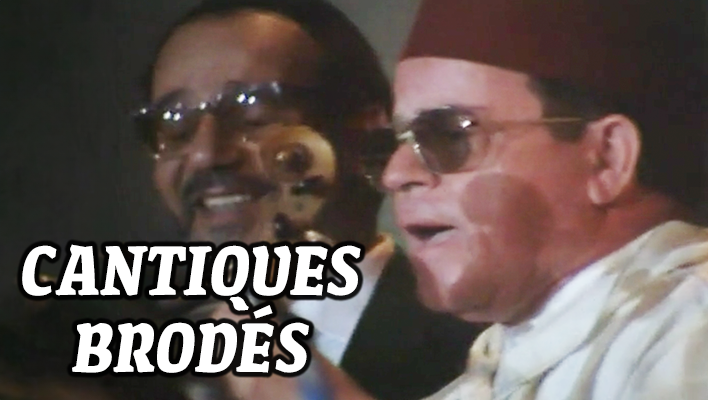
CANTIQUES BRODÉS
Accès abonnement
Dans ce film on assiste à la rencontre exceptionnelle à Paris des deux maîtres de musique arabo-andalouse, le rabbin Haim Louk et le maître Abdelsadek Chekara. On est témoin de comment Juifs et Musulmans marocains ont préservé avec ferveur les trésors de leur patrimoine musical commun. Hérité de l'Andalousie à son Age d'ôr, le matruz justifie les entrelas d'une «broderie».











